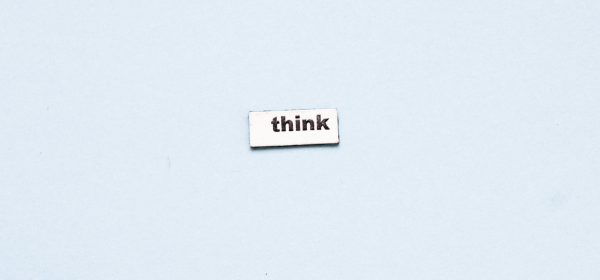Marre du télétravail ? Et si vous aviez un job « bleisure » !
Marre du télétravail ? Et si vous aviez un job « bleisure » !
Vu de loin, il semblerait que depuis le Covid nous aspirions à nous éloigner le moins possible de notre cocon douillet. Nous sommes éventuellement prêts à échanger avec le monde entier mais plutôt en visio, en direct depuis notre canapé.
Tandis que de nombreuses entreprises appellent au retour en présentiel, la question se pose des raisons qui font grogner plus d’un à la perspective de renoncer au travail au domicile, au risque de la cristallisation de tensions sociales. Et si, pour se sortir d’un débat binaire opposant le bureau à la maison, on s’inspirait du « bleisure » pour repenser les satisfactions à sortir de chez soi pour travailler ?
C’est quoi le « bleisure » ?
Voici un mot-valise : le « bleisure », contraction de « business » et « leisure » (loisirs). Longtemps avant qu’il ne porte ce nom, le « bleisure » était une des motivations premières des métiers de l’aérien : pilotes et personnel navigant commercial appréciaient les longs courriers qui permettaient de se poser quelques jours dans une destination lointaine pour faire un peu de tourisme avant de repartir dans l’autre sens. Même si les conditions de travail de ces « expatriés des airs » varient aujourd’hui beaucoup d’une compagnie à l’autre, l’idée du « bleisure » s’est installée dans d’autres métiers. Notamment ceux qui offrent l’occasion d’effectuer des voyages d’affaires en enchaînant trois jours de boulot à Hong Kong, Rio ou Dakar par quelques jours de vacances sur place.
La tendance s’étend aussi aux télétravailleurs qui ont pris le large à des centaines de kilomètres et s’offrent en tout bien tout honneur une double vie : des temps passés chez soi, à la campagne et en famille, et des temps passés au bureau, en profitant aussi des plaisirs plus individuels de la vie citadine (sorties, vie culturelle…). Ainsi, certains disent avoir (re)découvert la ville où ils ont vécu et travaillent encore quand ils l’ont quittée pour n’y revenir que quelques jours par semaine ou par mois. Comme des touristes dans leur propre cité d’origine !
A quels besoins répond le « bleisure » ?
La tendance « bleisure » nous interpelle sur les besoins fondamentaux auxquels répond le travail. D’abord nous permettre d’accéder une rémunération, d’accord. Mais tout de suite après, nous sortir de chez nous. Nous sortir de l’intimité et nous apporter un autre « espace-temps » fait de socialisation (rencontrer d’autres gens, notamment des personnes que l’on ne fréquenterait pas par affinité intuitive), de développement des compétences (en particulier, à travers la participation à une équipe de laquelle émerge de l’intelligence collective), d’identité alternative à celle que la famille et les proches nous renvoient.
Des « fonctions latentes » du travail impactés
Ces « fonctions latentes du travail » telles que la psychosociale Marie Jahoda les a identifiées ont cependant été négativement impactées par des évolutions de contexte au cours des 30 dernières années.
Il faut d’abord pointer du doigt la pénibilité des espaces-temps intermédiaires entre le foyer et le lieu de travail. Il peut se comprendre que le salarié qui a effectué des années durant un trajet domicile-travail quotidien dans des conditions inconfortables, fatigantes, stressantes préfère effectuer une fois par semaine un voyage de plusieurs heures en train dans des conditions paisibles.
Mais il faut aussi interroger les mutations des organisations du travail. Ainsi, l’augmentation du temps consacré à des tâches n’exigeant pas la conversation avec les autres et la coopération au sein du collectif déséquilibre la balance entre effort de se déplacer et plaisir de travailler sur site.
Autre évolution : l’augmentation manifeste de la pression temporelle. La culture du livrable (et son corollaire de tension sur les délais) a pour effet de faire primer le résultat du travail sur le process de travail, au risque de faire passer au second plan tout ce qui demande du temps, à savoir les processus collectifs et le temps de maturation nécessaire à l’appropriation des savoirs et compétences. De plus, la pression temporelle rend encore plus prégnante l’illusion de « gagner du temps » en s’épargnant des temps apparemment oisifs mais pourtant essentiels à l’équilibre dans le travail.
Retrouver l’esprit « bleisure » au travail
Conclusion : si l’on veut que le travail reste porteur de sens, producteur d’identité et facteur de développement des personnes, il nous faut injecter de l’esprit « bleisure » dans nos vies professionnelles.
Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?
- Alterner les temps de haute intensité et les temps de basse intensité. Chaque journée a besoin de son lot d’exigences et de challenge mais aussi de sa part d’insouciance et de confort.
- Gagner en mobilité. La pression temporelle et les évolutions technologiques nous amènent à faire énormément de choses en restant au même endroit, voire dans la même position. Notre corps aussi est là au travail, ne l’oublions pas : il a besoin de se déplacer, de se dégourdir, de s’exercer. Et notre cerveau a besoin de voir du paysage pour stimuler notre curiosité et notre capacité à nous inspirer.
- Réduire les pénibilités intermédiaires. La flexibilité des horaires permet de faire des trajets domicile-travail moins pénibles… Et pourquoi pas des trajets agréables où l’on a enfin du temps à soi pour bouquiner, pour rêver, pour écouter de la musique dans de bonnes conditions.
- Se projeter dans l’avenir avec une douce incertitude. La trajectoire professionnelle peut devenir une aventure si l’on ouvre ses horizons et que l’on s’autorise à prendre des chemins de traverse. Ne plus penser son parcours comme une ascension verticale mais comme une exploration avec ses escales, c’est peut-être une piste de décollage intéressante pour prendre son pied au travail.
Marie Donzel, pour le webmagazine Octave
Share this Post